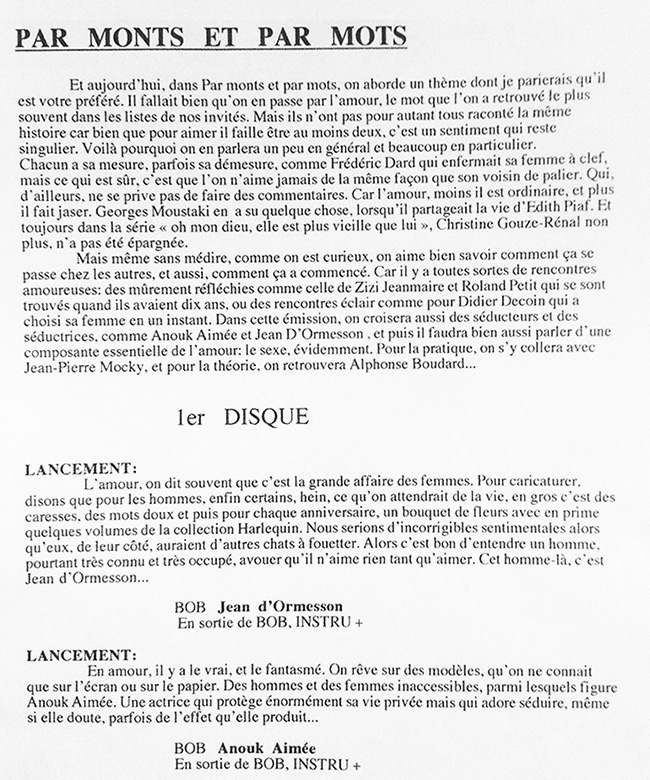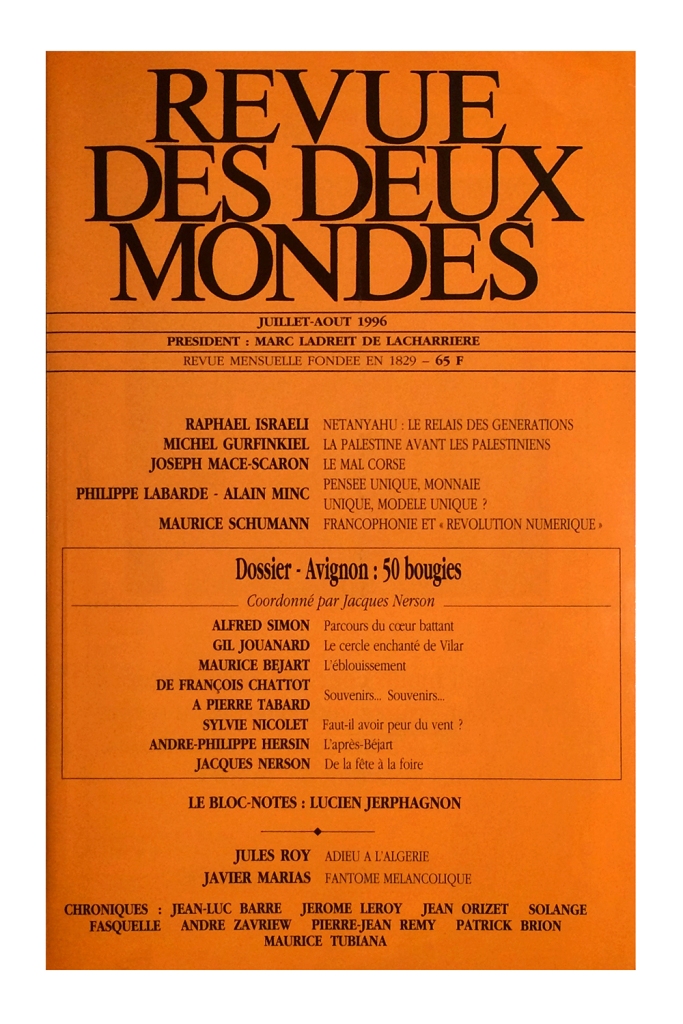A la télévision, il est aujourd’hui courant de « suivre » les gens. Tu as peut-être vu, ces jours derniers, le reportage sur la campagne d’Emmanuel Macron : un micro HF sur lui en permanence, une caméra discrète dans son sillage, des heures et des heures de rushes – on prend tout ce qui se présente, des jours et des jours de montage. A l’arrivée le produit est livré tel quel, sans commentaire pour expliquer ou lier les séquences. Il doit s’imposer de lui-même, sans qu’il soit besoin de le présenter.
C’est sur ce principe, appliqué aux artistes, qu’est construit Le Journal de la création.
Lorsque l’on prépare un documentaire classique, on le structure en amont. Avant qu’il n’existe en images, son chemin est tracé. Là, on part sans savoir. L’intérêt de ce qu’on va filmer, on ne pourra l’évaluer qu’après, car le sujet n’a pas besoin de nous pour s’inventer.
Sur le terrain, je suis couplée à un réalisateur. Il est essentiel de s’entendre, d’abord parce que l’on passe beaucoup de temps ensemble, y compris les soirées en province ou à l’étranger. Ensuite parce qu’il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas se parler et qu’il faut se comprendre sur un regard ou sur un signe. Ils sont deux, en alternance : Rémi Duhamel et Patrice Le Van Hiep. J’ai de la chance, je les aime tous les deux.
Pour mon baptême du feu, Rémi et moi partons à Montbéliard. Au programme : des repérages avec Jean-Pierre Mocky pour « Tout est calme », le film qu’il prépare.
Au téléphone, il m’a parlé de son scénario, une sombre histoire de confrérie avec de l’amour et des crimes. C’est assez confus mais je me dis que ça s’éclaircira. En réalité, dans cette intrigue, tout me semblera jusqu’au bout brouillon et chaotique.
Pour me remettre dans le bain, il y a quelques jours j’ai relu les critiques publiées quand le film est sorti. Dans Télérama, Pierre Murat restitue fidèlement ce que j’ai vu de l’intérieur. Pour justifier ce qu’il décrit comme un ratage, il conclut par ces mots : « C’est que Mocky, le pauvre, tourne ses films avec trois francs six sous. Et qu’à l’évidence, là, il manquait les trois francs »…
L’argent, c’est l’obsession de chaque instant. Dans tous les choix qu’il opère, le premier critère pour Jean-Pierre Mocky c’est le prix. Comme il s’autoproduit et que, de nature, il est franchement radin, il s’enthousiasme pour ce qui est gratuit.
A Montbéliard, nous visitons la forteresse dans laquelle il va installer sa secte, censée vivre en un lieu souterrain et secret. Il y a là quelques officiels, rapport aux autorisations. C’est un premier bon point : le décor ne lui coûtera rien. Il s’inquiète aussi des endroits où les acteurs pourront dormir et prendre leurs repas. Évidemment il cherche le moins cher, mais au moins il leur offre un lit. En ce qui le concerne, il estime qu’il n’en a pas besoin ; tout le temps du tournage, il dormira dans une école désaffectée. Avec son chien.
Pour la petite histoire, ce chien il ne l’a pas voulu. Il me confiera que c’est un cadeau de rupture, trouvé un matin sur son paillasson. Un autre que lui s’en serait probablement débarrassé, mais Mocky prend la vie comme elle vient : il n’avait pas de chien, eh bien il en a un…
Dès le premier jour de tournage, je comprends que « Tout est calme » ne figurera pas parmi les incontournables de sa filmographie.
D’abord, la plupart des acteurs sont insignifiants. On est loin, très loin des Michel Simon, Bourvil, Jacqueline Maillan, Jeanne Moreau ou Jean Poiret qui ont enchanté nombre de ses films. La seule tête connue, c’est celle de Noël Godin, l’entarteur belge, qui semble tombé là complètement par hasard.
Ensuite, il y a une pression permanente pour que chaque scène soit mise en boîte à la vitesse grand V. Sur n’importe quel plateau de cinéma, lorsque le metteur en scène dit « Moteur », on commence à tourner. Mocky, lui, lance le premier « Moteur » alors que ni les acteurs, ni les techniciens ne sont encore en place. À chaque fois le chef opérateur le lui fait remarquer, à chaque fois il s’énerve, crie, hurle des « Moteur » en rafales et finit au bord de la crise de nerfs. La première fois j’y crois, mais instantanément il se tourne vers moi, rigolard, et vient me glisser à l’oreille que c’est du chiqué, qu’il se conduit comme ça parce que sinon ça traîne, et que le temps, forcément, c’est de l’argent…
A un moment donné, il tourne une scène dans laquelle les personnages évoquent une histoire de passeports – qu’ils ont volés ou qu’ils ont falsifiés, je ne sais plus. Il est satisfait dès la première prise et s’apprête à poursuivre quand Edmond Richard – le directeur de la photographie qui tourne là son douzième film avec Mocky – lui dit que non, ça ne va pas. Pour lui, il faut que l’on voie les passeports, parce que sinon on ne comprend pas. Mais Mocky ne veut rien entendre et considère que la scène est bouclée. Cela va nous permettre, avec Rémi, d’enregistrer une séquence d’anthologie : à l’heure du déjeuner, alors que le plateau est déserté, Edmond Richard récupère discrètement les acteurs concernés et va tourner les plans manquants. En cachette…
Chaque journée que nous passons sur le film, en préparation, en tournage, en montage, s’achève par un temps d’interview. Avec les autres, j’ai toujours l’impression qu’ils réfléchissent en même temps qu’ils répondent aux questions. Avec lui non. Sur ce qu’il fait, sur ce qu’il est, il s’exprime sans filtre, sans louvoyer, probablement parce qu’il se contrefiche d’être jugé.
Tout au long de notre collaboration, il me parle beaucoup de sa vie personnelle, de ses échecs sentimentaux et de cette solitude dont il voudrait sortir. Il cherche une femme et préfèrerait que ce ne soit pas une comédienne, pour ne pas se sentir obligé de l’inclure dans chacun de ses films. Un jour il me demande s’il y a quelqu’un dans ma vie. Je dis que oui, il dit alors tant pis. C’est un homme sans chichis.
Je n’ai jamais vu le film terminé. D’habitude il y a une avant-première, une fête à laquelle je suis conviée. Pas chez Mocky car depuis longtemps déjà, ses films sortent en catimini.
Celui-ci, c’est peut-être le plus mauvais. Mais pas loin de 20 ans après, je crois que je vais, quand même, m’offrir le DVD.